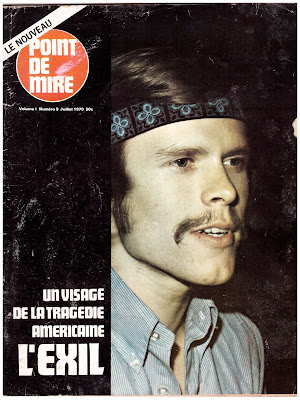D’autres ont sans doute craint, comme moi, le lent dépérissement d’un territoire qu’ils affectionnaient depuis longtemps, impuissants à freiner les mixtures toxiques d’agression industrielle et de négligence gouvernementale qui peuvent transformer un milieu attrayant en casse-tête de paysages désolants…
En 1973, j’ai découvert pour la première fois
le lac Sinclair, situé aux confins de la municipalité actuelle de La Pêche, à
70 km au nord-ouest du centre-ville de Gatineau, où l’une de mes futures
belles-sœurs avait fait construire un chalet. Il fallait rouler sur plus de 20
km de chemins de terre (de laveuse, plutôt) pour y arriver mais cela valait la
peine.
Après avoir traversé le joli village de
Ste-Cécile de Masham, le carrefour de Duclos et la localité d’East Aldfield
avec sa coquette petite église blanche, on débouchait sur le sympathique magasin
général de M. et Mme Bernier, porte d’entrée du sinueux chemin qui mène au lac
Sinclair, magnifique plan d’eau d'une longueur de 5 km avec de nombreuses baies, bordé de chalets
adossés à une forêt de feuillus qui rayonnait à perte de vue.
Mon épouse Ginette et moi y avons passé notre
lune de miel en 1975. Nos enfants y ont emmagasiné des tas de souvenirs… à
saveur de bonbons achetés chez Mme Bernier. Depuis le début des années 1990,
nous sommes copropriétaires d’un petit chalet, voisin de la propriété de ma
belle-sœur, maintenant résidente permanente au lac Sinclair. D’une année à
l’autre, les chênes, les érables, les grands pins blancs, les fleurs sauvages,
les couleurs automnales, sans oublier la vue sur le lac, ont laissé une
empreinte indélébile.
Bien sûr, tout change avec le temps, mais pas
toujours pour le mieux. Bien que les 22 km de laveuse aient été pavés,
l’entretien des routes laisse souvent à désirer et à de nombreux endroits, en
attendant des réparations qui tardent, les voitures doivent rouler au ralenti
pour tenter d’éviter des nids de poule capables de crever un pneu ou déboîter
une roue… Mais l’état des chemins suscite sans doute des jérémiades dans bien
d’autres localités et s’il ne s’agissait que de ça, on pourrait passer
l’éponge. Il y a plus, bien plus.
L’attrait du lac Sinclair, comme bien d’autres
endroits de villégiature, tient à la beauté de son cadre naturel, à sa
tranquillité ainsi qu’à son éloignement de la ville, des industries et des
autoroutes bruyantes. On pouvait, autrefois, s’y entendre parler à l’extérieur
en n’ayant dans les oreilles que le bruissement des feuilles dans le vent et
les chants des oiseaux, interrompus occasionnellement par le ronronnement d’un
moteur de voiture ou de bateau. Pour un citadin, cela ressemble beaucoup à un
coin de paradis.
Depuis une dizaine d’années, cependant, la
quiétude des environs (du moins près de la rive ouest du lac) est sérieusement
mise en péril. On voyait déjà, de temps en temps, de gros camions chargés de
billes de bois rouler sur nos routes de campagne, mais ils semblaient venir de
secteurs éloignés. Plus récemment, cependant, le déboisement s’est sérieusement
rapproché, au point de devenir visible même aux abords des chalets.
De grosses brèches apparaissent dans la forêt
sur des terres appartenant à des particuliers, et on peine à s’imaginer les
ravages causés plus loin, sur les terres de la Couronne, par des industries
comme Lauzon, de Papineauville (ses activités sont heureusement suspendues
durant cette période de pandémie), dont les routes d’accès forestières
débouchent directement sur le chemin du lac Sinclair, au milieu de la zone de
chalets…
Certains travaux en cours, tout près du
secteur habité, peuvent être fort bruyants et commencent parfois vers 7 heures
le matin… Pensez à l’effet sur une famille qui arrive pour quelques semaines de
vacances et qui doit endurer pendant des heures, tous les jours, le
vrombissement de scies mécaniques et de camions qui sont tout sauf silencieux…
Cet été, peut-être est-ce l’effet de la COVID, une tranquillité relative est
revenue, mais certains remarquent qu’on entend beaucoup moins qu’avant les
chants d’oiseaux… ce qui n’est guère surprenant vu que leur habitat rétrécit…
Quand les activités reprendront, les camions
lourds retrouveront leurs trajets et continueront à maganer les routes au
pavage fragile et à rouler avec fracas, parfois à des vitesses excessives sur
des routes sinueuses et étroites. À la pollution-par-le-bruit des opérations
industrielles forestières s’ajoute celle des motocross, des 4-roues et des autos et camions sans
silencieux qui semblent prendre plaisir à assourdir les passants à toutes
heures du jour. Il doit y avoir là-dedans quelque violation de règlements
municipaux, mais on a parfois l’impression que les élus de La Pêche ont peu d’intérêt pour
l’avenir du secteur, ou pire, s’accommodent trop d'activités qui semblent parfois
louches aux résidants et villégiateurs.
Ce laisser-aller, qui s'accompagne de multiples pollutions visuelles (signes visibles d'activité industrielle, détritus le long des chemins), s'ajoute à la perte de nombreux attraits locaux au fil des décennies - l'incendie de l'épicerie Labelle, renommée pour sa boucherie; la fermeture du magasin général Bernier au lac Sinclair et de tous les restos et bars du coin (Château Louise, le Carrousel, Chez Ghislaine); la démolition par le diocèse anglais de Pembroke (Ontario) de l'église française d'East Aldfield construite en 1885; la disparition du plus beau terrain de golf de normales 3 de l'Outaouais, le Club de golf Pontiac, laissé à l'abandon par le nouveau proprio). Heureusement nous avons toujours «Le p'tit magasin général» d'East Aldfield, sous excellente direction.
Il nous reste bien sûr le lac, et des territoires jusqu'à maintenant épargnés... mais pour combien de temps? Espérons une prise de conscience, par les autorités, des menaces qui pèsent sur ce joyau de l'Outaouais...
Il nous reste bien sûr le lac, et des territoires jusqu'à maintenant épargnés... mais pour combien de temps? Espérons une prise de conscience, par les autorités, des menaces qui pèsent sur ce joyau de l'Outaouais...